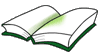| Titre : | Evaluation du risque infectieux fongique lié aux cathéters veineux au service de chirurgie de l’établissement hospitalier de Saïda |
| Auteurs : | RACHEDI Manel, Auteur ; NOUAR Leila, Auteur ; Habiba BELGACEM, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Dr. Moulay Tahar Université Saida, Faculté des Sciences Naturelles et de la Vie, 2024/2025 |
| Format : | 47 p / 29 CM |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Infections nosocomiales ; cathéters veineux périphériques ; contamination fongique ; Candida glabrata ; Candida krusei |
| Résumé : |
L’usage des cathéters intravasculaires représente une pratique médicale indispensable en
milieu hospitalier, facilitant l’administration de nombreux traitements et améliorant considérablement la prise en charge des patients. Toutefois, ces dispositifs peuvent constituer un vecteur de colonisation microbienne, notamment par des levures pathogènes du genre Candida, exposant ainsi les patients à un risque accru d’infections fongiques associées aux soins. Malheureusement, l’arsenal thérapeutique disponible pour la prise en charge de ces infections, reste très réduit en raison de la toxicité et/ou de l’apparition de résistance vis-à-vis de certains antifongiques notamment chez les immunodéprimés. Dans cette optique, une étude a été menée au sein de l’établissement hospitalier Ahmed MEDAGHRI à Saida, ayant pour objectif l’isolement et l’identification des souches fongiques et surtout les levures du genre Candida à partir de cathéters veineux périphériques laissés en place depuis au moins 48 heures et déterminer l’incidence et le degré de sensibilité de Candida spp. , isolées de cathéters veineux périphériques, à l’acide borique et à l’amphotéricine B. L’identification des souches isolées a été effectuée à l’aide d’une observation microscopique et utilisation de chromagar, Durant la période d’investigation, 30 prélèvements ont été réalisés sur des cathéters veineux périphériques, révélant un taux de contamination de 80%. Deux souches fongiques ont été identifiées : Candida glabrata et Candida krusei, toutes deux reconnues pour leur implication dans des infections nosocomiales et 05 souches de champignons filamenteuses. Ces résultats mettent en évidence la nécessité de respecter scrupuleusement les protocoles d’hygiène relatifs à la pose et à la gestion des cathéters, afin de limiter le risque de colonisation fongique et les complications infectieuses qui en résultent. |
| Note de contenu : |
Introduction générale .................................................................................................................1
Première partie : Revue bibliographique …………………………………………………….... A. Généralités……………………………………………………………………………..4 1/ Définition de cathéter veineux…………………………………………………………........4 1.1/ Les types de cathéters veineux……………………………………………………….......5 1.1.1/ Cathéters veineux périphériques (CVP)……………………………………………......5 1.1.2/ Cathéters veineux centraux (CVC)…………………………………………………......6 1.2/ Utilisation des CVP en chirurgie………………………………………………………….6 1.3/ Durée de maintien des CVP……………………………………………………………....7 1.3.1/ Facteurs influençant la durée de maintien……………………………………………....7 1.4 / Complications liées aux CVP…………………………………………………………….9 1.4.1/ Complications infectieuses……………………………………………………………..9 2/ Les infections liées aux cathéters…………………………………………………………...9 2.1/ La différence entre la colonisation, l’infection locale et l’infection systémique……......9 B. Étiologie et physiopathologie…………………………………………………………..101/ Principaux agents fongiques en cause ……………………………………………………..10 1.1/ Levure …………………………………………………………………………………...10 1.1.1/ Candida albicans……………………………………………………………………....10 1.1.2/ Candida parapsilosis…………………………………………………………………..11 1.1.3/ Candida glabrata………………………………………………………………………11 1.2/ Champignon ……………………………………………………………………………..11 1.2.1/ Aspergillus ……………………………………………………………………………11 1.2.2/ Penicillium …………………………………………………………………………….12 1.2.3/ Rhizopus ……………………………………………………………………………….12 1.2.4/ Fusarium……………………………………………………………………………….12 1.2.5/ Mucor ………………………………………………………………………………….13 2/ Mécanisme d’infection et de formation de biofilm ………………………………………..13 2.1/ Mode d’adhésion des champignons aux surface des cathéters ……………………….....13 a/ Adhésion initiale et reconnaissance de surface …………………………………………....14 b/ Implication des adhésines spécifiques de Candida ………………………………………..14 c/ Développement du biofilm sur le cathéter ………………………………………………...14 2.2/ Le développement du biofilm fongique et la résistance aux antifongiques …………….14 2.3/ Facteurs favorisants la formation du biofilm …………………………………………...15 C. Diagnostic des infections fongiques……………………………………………………16 1/ Manifestations cliniques…………………………………………………………………..16 1.1/ Les Signes locaux………………………………………………………………………..16 1.2/ Les Signes systémiques……………………………………………………………….....16 2/ Les Méthodes de détection………………………………………………………………...17 D. Facteurs de risque……………………………………………………….......................17 1/ Les facteurs de risques liées aux cathéters………………………………………………..17 E. Prévention……………………………………………………………………………...19 1/ Mesures de prévention…………………………………………………………………….19Deuxième partie : Matériels et méthodes …………………………………………………… 1. Collecte des données……………………………………………………………………….21 2. Éthique…………………………………………………………………………………......21 3. Prélèvements……………………………………………………………………………….21 4. Isolement et purification…………………………………………………………………...22 5. Identification des souches………………………………………………………………….23 5.1/ Identification microscopique…………………………………………………………….23 5.2/ Identification des levures par le CHROMagar Candida………………………………...23 5.3/ Identification des moisissures …………………………………………………………..25 6/ Étude phénotypique de la résistance des isolats de Candida spp aux agents antifongiques ……………………………………………………………………………...….25 6.1/ Test de sensibilité à l’acide borique……………………………………………………..25 6.2/ Test de sensibilité à l’Amphotéricine B ………………………………………………...25 6.2.1/ Méthode sur milieu solide ………………………………………………………….....25 7/ Test du filament germinatif (Germ Tube Test) ……………………………………………26 7.1/ Test de blastèse ………………………………...………………………………………..26 8/ La mise en évidence des activités antifongique du miel contre les souches de candida isolées ……………….……………………………………………………………………......26 8.1/ Méthode de diffusion sur gélose …...................................................................................26 Troisième partie : Résultats et discussions …………………………………………………… 1/ Profil des patient durant l’hospitalisation……………………………………………........29 2/ Âge et durée de cathétérisme ………………………………………………………...........29 3/ Prévalence des cathéters colonisés par des microorganismes …………………………....30 4/ Fréquence d'isolement des germes à partir de cathéters veineux périphériques……….…31 5/ Identification macroscopique des souches isolées……………………………………..…32 6/ Identification microscopique des souches isolées (Levures et champignons)…………...36 7/ Culture et identification des souches isolées de Candida ………………………………..39 8/ Résultat du test de blastèse (ou test de germination de Tschadjian)………………………409/ Résultat de l’activité antifongique ………………………………………...………………40 9.1/ Résistance à l’acide borique……………………………………………………………...40 9.2/ Résistance à l’amphotéricine B …………………………………………………………41 10/ Résultats des tests d’activité antifongique (méthode des disques) ………………………43 11/ Interprétation et discussion des résultats ……………………………………..………....44 Conclusion générale .................................................................................................................47 Référence bibliographique ........................................................................................................ Annexe........................................................................................................................................ |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 000241 Adobe Acrobat PDF |